Le dilemme est connu et appelle des choix: faut-il changer et vivre ou rester tel quel et disparaître ?

L’Amérique se détache de ce qu’on nommait l’Occident, la Chine se rapproche de l’Europe, l’Orient est en pleine mutation, les pays des BRICS cherchent leurs dénominateurs communs pour devenir une entité politique, l’Europe prend conscience d’elle-même et de la forte singularité de sa culture, les catastrophes naturelles se multiplient à rythme de plus en plus fréquent. Ne serait-il pas illusoire de penser que le tourisme, au milieu de toutes ces évolutions majeures et rapides, puisse rester celui que nous connaissons ? Comment va-t-il se transformer ?

Les flux touristiques mondiaux pourraient être reconfigurés
Si l’Amérique du Nord se détache de l’Occident au sens classique, les flux touristiques entre l’Europe et les États-Unis pourraient ralentir, au profit d’échanges renforcés entre l’Europe et l’Asie. Une Chine qui se rapprocherait culturellement, économiquement et politiquement de l’Europe pourrait générer une hausse des échanges touristiques, y compris vers des destinations moins classiques vers l’intérieur de la Chine par exemple, vers les Balkans, le Caucase… L’émergence des BRICS en tant que pôles touristiques pourrait consolider une identité politique recherchée, mais aussi développer des circuits touristiques intra-BRICS, voire offrir une alternative aux destinations occidentales classiques.

Prise de conscience environnementale
Avec l’accélération des catastrophes naturelles, les voyageurs — mais aussi les États — vont favoriser un tourisme durable, local, plus lent. Moins de vols long-courriers, plus de voyages en train, retour du slow travel. Il est probable que les destinations qui montrent une gestion écologique efficace (protection de la biodiversité, réduction des émissions, infrastructures vertes) gagneront en attractivité. Canicules et sécheresses rendent déjà certaines zones des Suds européens quasi invivables l’été.
S’y ajoutent les incendies, les pénuries d’eau, la pollution de l’air et la montée des eaux. Il est évident aussi que de nouveaux pôles touristiques tels la Scandinavie, l’Ecosse, l’Irlande, les régions montagneuses voire certaines zones d’Europe centrale montent en puissance ces dernières années. Ils sont devenus des refuges climatiques et sont attractifs à la fois pour leur fraîcheur, leur nature préservée, leur eau, et une forme de tranquillité climatique.

Revalorisation du patrimoine culturel européen
Dans un monde multipolaire, l’Europe pourrait se redécouvrir comme un îlot de culture, d’histoire et d’identité singulière. Cela pourrait créer un regain d’intérêt pour ses richesses patrimoniales, ses langues, ses traditions locales. Cela pourrait favoriser une forme de tourisme « du savoir » : apprendre, comprendre l’Europe, ses racines, son rôle dans le monde. Un même phénomène pourrait se développer côté Asie ou Moyen-Orient.

Technologies et nouvelles expériences changent déjà la donne
Même si, dans l’immédiat ces technologies restent limitées, les mutations globales et les crises climatiques, géopolitiques, pourraient favoriser le développement d’expériences touristiques virtuelles ou mixtes — surtout pour ceux qui ne peuvent plus voyager loin. Mais grâce aux données des IA, les offres touristiques seront de plus en plus ciblées, adaptées au profil culturel, linguistique, écologique ou politique du voyageur.

Inégalités d’accès et tourismes multiples
Il est fort probable que nous assistions à une plus grande fragmentation du tourisme avec d’un côté un tourisme d’élite (international, haut de gamme, dans des zones stables) et de l’autre un tourisme régional (proche, modeste, écologique). Et il faut évoquer une troisième voie, celle d’un tourisme exclu pour tous ceux qui n’ont et n’auront plus accès au voyage faute de moyens ou à cause des contraintes climatiques.
Sans doute aussi, on l’a vu lors des confinements, certains iront-ils chercher ailleurs ce qu’ils ne trouvent plus chez eux comme la sécurité, le calme, les ressources, brouillant ainsi les frontières entre tourisme, migration, nomadisme. Les classes les plus aisées continueront de voyager, mais différemment : moins souvent, plus longtemps, plus loin, dans des conditions très maîtrisées, dans des resorts protégés, des éco-lodges haut de gamme, des croisières privées, des îles sécurisées.
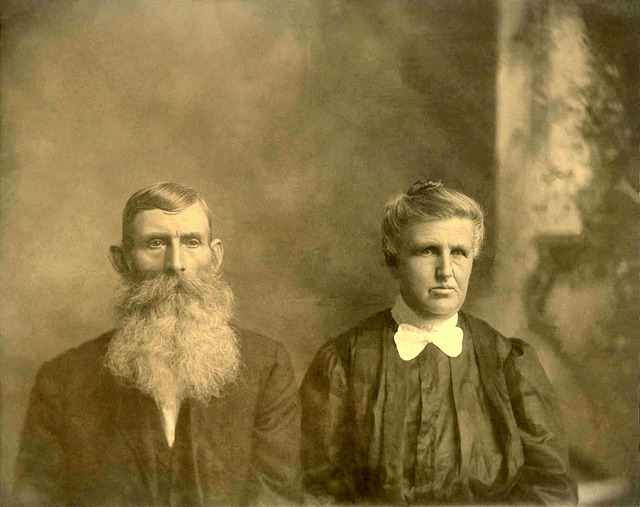
Une question de classes…
Les classes moyennes devront faire des choix : moins de départs, voyages plus courts, plus proches, hors saison avec une revalorisation du tourisme rural, du camping, de la « vanlife », parfois plus subie que choisie. Cette façon de voyager s’accompagnera partiellement d’une recherche de sens avec des expériences authentiques, une immersion locale voire du tourisme solidaire. C’est déjà en cours.
Par contre il est à craindre l’exclusion progressive des classes populaires parce que partir en vacances deviendrait un luxe inaccessible. La hausse des prix de transport, des taxes, d’hébergement, d’alimentation deviennent une barrière économique directe rendant le voyage inaccessible.
Bien sûr, nul n’a de boule de cristal, ni de don de voyance pour appréhender un avenir multifactoriel difficile à appréhender mais les sociologues pourront prendre le tourisme à témoin ; il deviendra un véritable révélateur des fractures et des alliances du monde futur.



